Bienvenue sur les pages du Ministère fédéral des Affaires étrangères
Entretien avec Heike Raab, secrétaire d'Etat de la Rhénanie-Palatinat, et Jacques Witkowski, préfet de région Grand Est
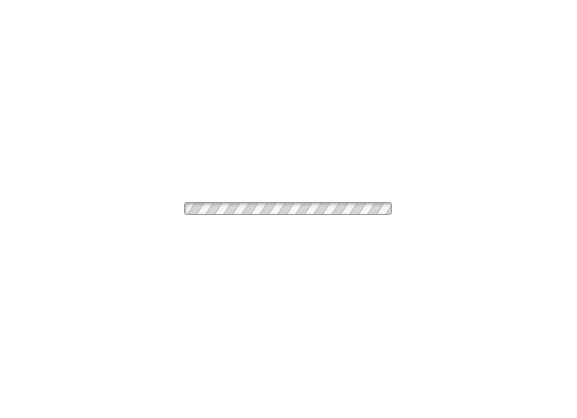
Quelles sont les priorités de la Rhénanie-Palatinat pour la prochaine session du CCT ? Qu’est-ce que vous attendez de cette réunion du Comité dans votre Land ?
Heike Raab: Au sein du Comité de coopération transfrontalière franco-allemande, la Rhénanie-Palatinat souhaite définir avec ses partenaires des priorités à la fois claires et tournées vers l'avenir. Nous sommes engagés dans l'espace de coopération de la Grande Région et dans celui du Rhin supérieur. Nous prenons ainsi nos responsabilités vis-à-vis de l'Europe et des thèmes européens importants en étroite concertation avec nos voisins français... Nous voulons faire avancer l'avenir de l'Europe, et la transformation de l'économie et du marché du travail en Allemagne et en Europe. Le renforcement de l'aide transfrontalière en cas de catastrophe est également une priorité pour nous. Que ce soit lors de conditions météorologiques extrêmes ou d'événements tels que les incendies de forêt ou les inondations, seule une approche européenne commune et une coopération coordonnée entre les autorités nous permettront de nous préparer au mieux aux situations de crise et d'agir efficacement. Notre objectif est de trouver des solutions pratiques pour des interventions efficaces et rapides dans l'espace frontalier franco-allemand. Il s'agit notamment d'harmoniser les réglementations ou de mettre en place une structure de communication transfrontalière afin de gagner du temps et de protéger les vies humaines en cas d'urgence. En outre, nous accordons une grande importance au développement des énergies renouvelables, dont la géothermie. Nous y voyons un énorme potentiel pour façonner de manière durable la transition énergétique européenne et les évolutions économiques. Dans le fossé du Rhin supérieur en particulier, il existe une opportunité pour exploiter les ressources géothermiques et contribuer ainsi de manière significative à l'approvisionnement énergétique régional et européen. Dans ce contexte, il nous importe de communiquer de manière anticipée et transparente sur les risques potentiels, d'adapter le cadre juridique et de renforcer l'acceptation par la population. C’est la seule manière pour exploiter pleinement le potentiel de la géothermie tout en continuant à consolider l'idée européenne de la coopération. De la session du CCT, nous attendons donc des impulsions concrètes pour des projets innovants qui approfondissent aussi bien l'amitié franco-allemande que l'intégration européenne. En exploitant encore plus intensément les synergies existantes et en mettant en commun nos expériences, nous pouvons apporter une contribution importante à la prévention des crises et à l'avenir énergétique de l'Europe.
La Rhénanie-Palatinat avoisine trois Etats : la France, le Luxembourg et la Belgique. Selon vous, quelles sont les particularités dans les relations avec ces partenaires ?
Heike Raab: La Rhénanie-Palatinat a des frontières communes avec trois pays européens – la France, le Luxembourg et la Belgique. Ici, l'esprit de la cohabitation européenne est – et doit être – réinventée chaque jour. En tant que pays situé au centre des membres fondateurs de l'UE, et alors que nous fêtons les 75 ans de la déclaration Schuman, il apparaît une fois de plus que l'intégration européenne est implantée de manière particulièrement solide à l’échelle régionale. Notre espace frontalier, dans lequel se rencontrent différentes cultures, structures économiques et traditions, est le lieu où l'Europe est vécue et façonnée activement. La Rhénanie-Palatinat se veut être un pivot central, un pont entre les États voisins et la communauté européenne. Les relations de longue date et profondément enracinées avec la France vont bien au-delà des coopérations politiques et reflètent le dialogue continu et la responsabilité commune qui caractérisent la cohésion européenne. Parallèlement, des partenariats étroits et basés sur la confiance avec le Luxembourg et la Belgique renforcent notre engagement en faveur d'une coopération solidaire et tournée vers l'avenir. C'est précisément en ces temps de défis mondiaux qu’on voit l'importance de partenaires fiables – des partenaires avec lesquels nous partageons une amitié européenne expérimentée, fondée sur la confiance, le respect et la recherche commune de la paix et du progrès.
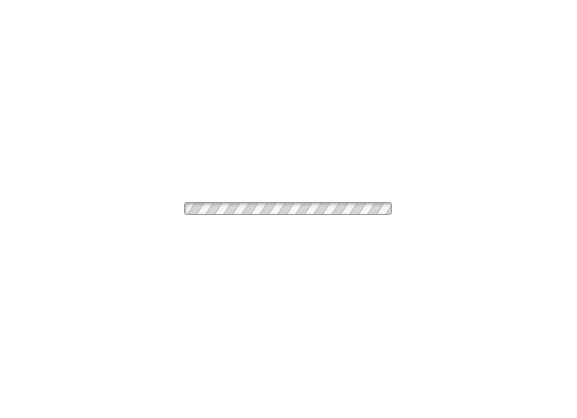
Vous avez pris vos fonctions de Préfet de la Région Grand Est à l’automne dernier. La coopération transfrontalière avec l’Allemagne fait-elle partie de vos priorités ?
Jacques Witkowski: En prenant mes fonctions en tant que préfet de la région Grand Est, je savais que la coopération transfrontalière serait un axe important de mon travail. Depuis, je ne peux que constater sa vitalité que j’avais déjà expérimentée il y a une vingtaine d’années en tant que sous-préfet de Sélestat. La région partage près de 800 km de frontières avec l’Allemagne, la Suisse, le Luxembourg et la Belgique, la coopération avec ces pays est donc naturellement une priorité des services de l’État en Grand Est et constitue une partie intégrante de ma feuille de route. Dans ce cadre, la coopération avec l’Allemagne constitue un axe majeur, lié à l’importance historique, géographique, économique, sociale et culturelle de nos liens. Il se décline à travers toutes les politiques publiques et j’en citerai ici que quelques-unes :
l’ordre public et la sécurité civile : que ce soit à travers le Centre de coopération policière et douanière, l’unité opérationnelle franco-allemande, la brigade fluviale franco-allemande sur le Rhin ou les échanges entre services de gestion de crises et de pompiers, la coopération est concrète et quotidienne. En travaillant ensemble, professionnels français et allemands contribuent à assurer la sécurité de nos concitoyens au-delà de la frontière. C’est un axe central amené à s’approfondir alors que nous nous apprêtons à fêter les 40 ans de l’espace Schengen.
la santé : l’expérience de la pandémie nous a rappelé avec force, l’importance de ce volet de la coopération. Des accords transfrontaliers existent pour l’aide médicale d’urgence ou la coopération par filière entre hôpitaux mais je souhaiterais que nous allions plus loin dans ce domaine. Ensemble, nous devons être plus ambitieux en engageant une réflexion partagée sur les besoins réciproques et la manière d’y répondre.
la mobilité : à l’intersection de grands corridors européens, nous devons œuvrer au sein de notre région pour faciliter davantage la mobilité de nos concitoyens, que ce soit au niveau local pour les petits trajets du quotidien, ou au niveau plus global en s’inscrivant dans les grands axes de circulation. Pour cela, nous comptons aussi sur le soutien financier de l’Union européenne pour mener des projets favorisant les interconnections et la multimodalité, dans un esprit de développement durable respectueux de l’environnement.
L’espace transfrontalier est souvent qualifié de « laboratoire franco-allemand de l’intégration européenne ». Avez-vous le sentiment qu’une véritable « conscience civique européenne » existe dans la population ?
Jacques Witkowski: Ce qui est vrai c’est qu’ici, peut-être plus qu’ailleurs, les autorités publiques sont particulièrement attachées à la construction européenne. C’est bien sûr le résultat de son histoire mais aussi de l’engagement de femmes et hommes politiques qui cultivent l’héritage des pères fondateurs de l’Europe. A Strasbourg en particulier, capitale de l’Europe démocratique et des droits de l’homme, nous œuvrons collectivement en faveur du projet européen qui est le seul à garantir la paix, la prospérité et la stabilité. Ainsi, à travers le contrat triennal « Strasbourg, capitale européenne », l’Etat et les collectivités territoriales investissent pour conforter et amplifier les fonctions de capitale européenne assumées par Strasbourg. De nombreux projets portés par des citoyens sont accompagnés dans ce cadre et permettent de faire rayonner les valeurs qui nous unissent. Il est toutefois à noter que la région Grand Est n’est pas celle où les électeurs se mobilisent le plus aux élections européennes (52% contre 57% en Bretagne par exemple). Il ne faut donc pas considérer l’attachement européen comme un acquis mais au contraire le cultiver au quotidien, auprès des concitoyens, en montrant les réalisations et réussites de l’Europe au sein de notre région frontalière.
Les échanges dans l’aire transfrontalière sont très denses, à la fois pour la mobilité de la main d’œuvre et pour la fourniture de biens et de services entre les entreprises. Comment le CCT peut-il, selon vous, contribuer à résoudre les difficultés rencontrées ?
Heike Raab: Le CCT apparaît comme un instrument essentiel et unique pour coordonner l'administration de l’État et des collectivités territoriales en matière de coopération transfrontalière. Grâce au traité d’Aix-la-Chapelle – qui doit être mis en œuvre par l’intermédiaire du CCT –, nous pouvons doter les collectivités territoriales et les entités transfrontalières de compétences, de ressources et de procédures appropriées, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle transeuropéenne. Le Comité permet de réaliser ensemble des projets transfrontaliers communs, offrant ainsi un cadre et un levier pour réduire les obstacles à la coopération. Dans un espace où la Grande Région et le Rhin Supérieur figurent parmi les régions les plus dynamiques d’Europe et du monde, il est impératif d’approfondir ce riche tissu de relations. En connectant les acteurs économiques, institutionnels et politiques de part et d’autre de la frontière, le CCT contribue à structurer et dynamiser les échanges, qu’il s’agisse de la mobilité de la main-d’œuvre ou de la fourniture de biens et de services. En somme, cette approche intégrée est cruciale pour renforcer la compétitivité régionale et pour consolider le lien européen dans un contexte global de défis communs.
Jacques Witkowski: Le CCT doit être le cadre pour faire dialoguer les acteurs franco-allemands compétents et proposer des solutions concrètes et pragmatiques, y compris, si besoin, par le biais de dérogations. Le Comité alerte les ministères concernés dans les capitales, sur des difficultés et contribue à la recherche de solutions comme pour la fiscalité des frontaliers par exemple. La coopération transfrontalière ici est ancienne mais c’est la première fois que nous avons une instance réunissant tous les acteurs de la frontière franco-allemande, du Nord au Sud, en passant du niveau local à l’échelon national, associant pouvoir exécutif et législatif. Cela reste une institution jeune, qui a fait naître beaucoup d’espoir au moment de sa mise en place, mais qui doit encore s’affirmer. J’invite tous les membres du CCT à s’en saisir dans la palette de leurs possibilités et le secrétariat du CCT de s’atteler à la tâche en apportant son expertise et son soutien. Nous devons aussi bénéficier pour cela de l’appui des capitales. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour acculturer les administrations à l’expérimentation pourtant nécessaire en matière de coopération transfrontalière.
L'espace frontalier franco-allemand est marqué par de nombreux points communs en matière d'histoire et de culture. Dans quelle mesure les établissements d'enseignement, les médias et les collectivités territoriales pourraient-ils encore mieux transmettre cela aux nouvelles générations ?
Heike Raab: L'espace frontalier franco-allemand est riche de racines historiques et culturelles communes. Autrefois ennemis acharnés, nos pays se sont transformés en un moteur de l'intégration européenne. Cette transformation par le rapprochement va au-delà de jalons comme la déclaration Schuman et a été renforcée par des accords novateurs comme le traité de l'Élysée et le traité d'Aix-la-Chapelle. En Rhénanie-Palatinat, nous sommes également fiers et reconnaissants à l'occasion d'un anniversaire particulier : le 40e anniversaire de l'accord de Schengen. L'ouverture des frontières et la liberté de circulation sont l'une des plus grandes réalisations de l'Europe. Qu'est-ce qui est encore important ? Les établissements d'enseignement jouent un rôle crucial pour notre avenir. Grâce à des programmes éducatifs transfrontaliers, des projets communs et des initiatives d'échange, les élèves peuvent voir de près comment les inimitiés historiques se sont transformées, au cours des dernières décennies, en une base de coopération et de compréhension mutuelle. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des faits historiques, mais aussi les étapes centrales qui ont marqué ce processus. Les médias contribuent eux aussi largement à rendre ce processus de transformation vivant. Grâce à des formats, des documentaires et des rapports innovants, ils peuvent présenter l'héritage de la réconciliation et l'importance de ces étapes de manière transparente et attrayante. Cela permet de faire prendre conscience de la valeur du projet européen commun et de motiver les jeunes générations à participer activement à la construction de l'avenir. Enfin, les collectivités territoriales soutiennent la préservation et le développement du patrimoine diversifié de l'espace frontalier franco-allemand par des initiatives culturelles ciblées, des programmes de soutien et des manifestations communes. En plaçant l'histoire, la culture et ces traités précurseurs au cœur de leur travail, elles créent un fondement durable pour une identité européenne vivante et tournée vers l'avenir. De cette manière, le passé mouvementé – de l'ancien « ennemi héréditaire » à un puissant moteur de l'intégration européenne – ne permet pas seulement de tirer des leçons pour l'avenir ; les jalons de ce parcours servent également d'exemples inspirants pour les générations futures.
Jacques Witkowski: Beaucoup a été fait mais je suis convaincu qu’il reste encore plus à faire : cela passe certes par l’apprentissage de la langue du voisin, mais aussi l’éveil sur la culture et l’histoire locales, la curiosité pour l’autre, si proche. Pour cela il convient d’utiliser les outils, les références et les moyens de communication qui parlent aux jeunes générations qui prendront ensuite le relai pour faire vivre l’esprit européen. Il faut également développer le tourisme et les échanges de jeunes dans le domaine de la protection de l’environnement, de la sauvegarde du patrimoine ou la participation croisée à de grands évènements. A ce titre nous avons été très heureux de donner une dimension transfrontalière au parcours de la flamme olympique vers Paris.
